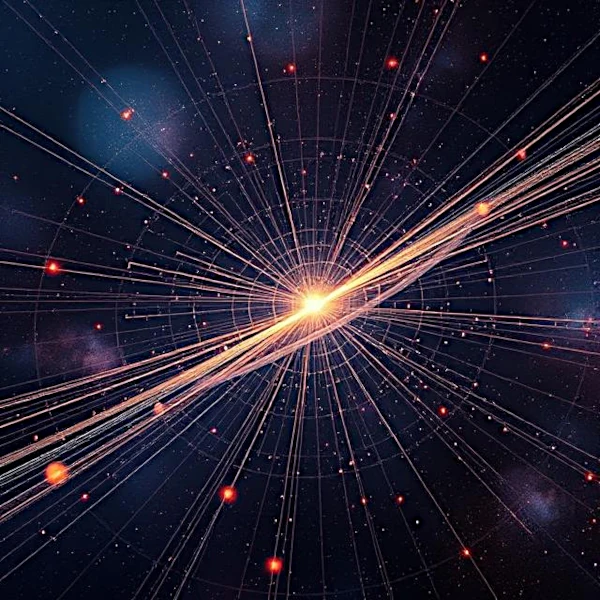
La masse est l’une des propriétés les plus fondamentales de la matière. Elle détermine la résistance d’un corps à l’accélération (masse inertielle) et la force gravitationnelle qu’il exerce ou subit (masse gravitationnelle). Longtemps considérée comme intrinsèque, la masse est aujourd’hui comprise comme un phénomène émergent dans le cadre du modèle standard de la physique des particules.
La masse inertielle quantifie la résistance d’un objet à toute variation de son état de mouvement. Elle apparaît dans la deuxième loi de Newton : \( \vec{F} = m_i \cdot \vec{a} \). Plus la masse inertielle est grande, plus il faut de force pour produire une même accélération.
La masse gravitationnelle détermine l’intensité de la force gravitationnelle qu’un objet subit ou exerce. Dans la loi de Newton, elle apparaît sous la forme : \( F = G \cdot \dfrac{m_g M}{r^2} \), avec \( m_g \) la masse gravitationnelle.
Fait fondamental : dans toutes les expériences, ces deux masses sont numériquement équivalentes. Ce constat expérimental, à savoir qu’un objet lourd ou léger tombe avec la même accélération dans le vide, fonde le principe d’équivalence d’Einstein. Il est au cœur de la relativité générale.
Cependant, cette équivalence est un postulat et non une nécessité théorique. Toute différence, même infime, entre \( m_i \) et \( m_g \) pourrait révéler une nouvelle physique. Des missions comme MICROSCOPE ont testé ce principe à 1 partie sur \( 10^{15} \), sans écart détecté à ce jour.
| Type de masse | Définition | Formule associée | Mesure expérimentale |
|---|---|---|---|
| Masse inertielle (\( m_i \)) | Résistance à l’accélération (dynamique) | \[ \vec{F} = m_i \cdot \vec{a} \] | Via des forces appliquées (pousser, tirer) |
| Masse gravitationnelle (\( m_g \)) | Interaction avec le champ gravitationnel | \[ F = G \cdot \dfrac{m_g M}{r^2} \] | Via le poids ou la chute libre |
| Principe d’équivalence | \( m_i = m_g \) | Accélération identique en chute libre | Vérifiée avec une précision extrême |
Références :
• Galilée G., Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, 1632.
• Einstein A., Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, 1916.
• Touboul P. et al., MICROSCOPE Mission: First Results of a Space Test of the Equivalence Principle, Phys. Rev. Lett. 119, 231101 (2017).
• Will C.M., The Confrontation between General Relativity and Experiment, Living Rev. Relativity 17, 4 (2014).
Dans le modèle standard, le vide n’est pas vide : il est rempli d’un champ scalaire appelé champ de Higgs. Lors de la brisure spontanée de symétrie électrofaible, ce champ acquiert une valeur non nulle dans tout l’espace. Les particules interagissent avec ce champ, et cette interaction leur confère une masse proportionnelle à leur couplage avec le champ. Le boson de Higgs, découvert en 2012, est l'excitation quantique de ce champ.
Les quarks (éléments constituants des protons et neutrons) possèdent une toute petite masse issue du champ de Higgs, mais l’essentiel de la masse du nucléon (plus de 98%) provient de l’énergie de liaison des quarks via l’interaction forte (chromodynamique quantique). Ce phénomène est un exemple frappant de l’équivalence masse-énergie : \(E=mc^2\).
| Objet | Masse (MeV/$c^2$) | Origine principale | Part du champ de Higgs |
|---|---|---|---|
| Électron | 0,511 | Champ de Higgs | 100% |
| Quark up | 2,2 | Champ de Higgs | 100% |
| Proton | 938 | Énergie de liaison QCD | <2% |
| Neutron | 939 | Énergie de liaison QCD | <2% |
Références :
• Higgs P., Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons, Phys. Rev. Lett. 13, 508 (1964).
• Aad G. et al., Observation of a New Particle in the Search for the Standard Model Higgs Boson, Phys. Lett. B 716, 1–29 (2012).
• Peskin M.E. & Schroeder D.V., An Introduction to Quantum Field Theory, Addison-Wesley (1995).
• Particle Data Group, pdg.lbl.gov.
La relativité restreinte (\(E=mc^2\)) établit que masse et énergie sont équivalentes.
La relativité générale (\( R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \)) décrit la masse (et l’énergie) comme source de courbure de l’espace-temps. Toute forme d’énergie, y compris celle d’un champ ou du vide, courbe l’espace et produit un effet gravitationnel.
Si le champ de Higgs explique aujourd’hui l’origine de la masse des particules élémentaires via leur interaction avec le vide quantique, la nature profonde de ce champ, sa stabilité dans le temps et surtout la valeur précise de son énergie de vide demeurent des énigmes théoriques. En effet, l’énergie du vide prédite par la mécanique quantique relativiste, et donc sa masse gravitationnelle équivalente, devrait engendrer une courbure de l’espace-temps colossale, incompatible avec l’expansion modérée observée de l’univers. Cette incohérence constitue le célèbre problème de la constante cosmologique, lié à la valeur observée de \( \Lambda \) dans les équations d’Einstein :
\[ R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \]Ce décalage de plus de 120 ordres de grandeur entre la valeur théorique attendue et celle mesurée de la constante cosmologique est sans doute le plus grand écart jamais rencontré entre théorie et observation en physique fondamentale. Il soulève des questions profondes sur la relation entre la masse inertielle, la masse gravitationnelle et la structure même du vide quantique.
La constante cosmologique \( \Lambda \), introduite initialement par Einstein dans ses équations de la relativité générale, correspond à une densité d’énergie du vide qui influence l’expansion de l’Univers. Elle est reliée à une densité effective d’énergie par :
\[ \rho_{\Lambda}^{\mathrm{obs}} = \dfrac{\Lambda c^{2}}{8\pi G} \]Les observations cosmologiques, notamment celles issues du fond diffus cosmologique, indiquent que cette densité est extrêmement faible. Or, la théorie quantique des champs, qui considère les contributions de toutes les fluctuations du vide jusqu’à une coupure à haute énergie (souvent l’échelle de Planck), prévoit une densité du vide immense.
Le décalage entre la prédiction théorique \( \rho_{\text{vide}}^{\mathrm{th}} \) et la valeur mesurée \( \rho_{\Lambda}^{\mathrm{obs}} \) est de l’ordre de :
\[ \frac{\rho_{\text{vide}}^{\mathrm{th}}}{\rho_{\Lambda}^{\mathrm{obs}}} \sim 10^{120} \text{ à } 10^{123} \]Ce décalage de plus de 120 ordres de grandeur est sans précédent dans l’histoire de la physique théorique. Il souligne un désaccord fondamental entre la relativité générale (gravitation) et la mécanique quantique (champs). Le problème de la constante cosmologique est l’un des plus grands mystères de la physique fondamentale.
| Quantité | Valeur typique | Unités | Origine |
|---|---|---|---|
| \( \rho_{\text{vide}}^{\mathrm{th}} \) | \( \sim 10^{113} \) | J m\(^{-3}\) | Fluctuations du vide à l’échelle de Planck |
| \( \rho_{\Lambda}^{\mathrm{obs}} \) | \( \sim 10^{-10} \) | J m\(^{-3}\) | Déduite de l’expansion accélérée |
| Rapport | \( \sim 10^{123} \) | sans dimension | Écart théorie vs observation |
Dans les unités naturelles utilisées en physique des particules, cette densité s’exprime en GeV\(^4\) :
Ce désaccord profond indique que quelque chose d’essentiel nous échappe dans la compréhension du vide quantique ou dans le mécanisme même de gravitation à grande échelle. Ce paradoxe est au cœur des recherches sur une théorie unifiée de la gravité quantique.
Références :
• Weinberg S., The Cosmological Constant Problem, Rev. Mod. Phys. 61, 1 (1989).
• Carroll S.M., The Cosmological Constant, Living Rev. Relativity 4, 1 (2001).
• Planck Collaboration, Cosmological parameters, A&A 641, A6 (2020).