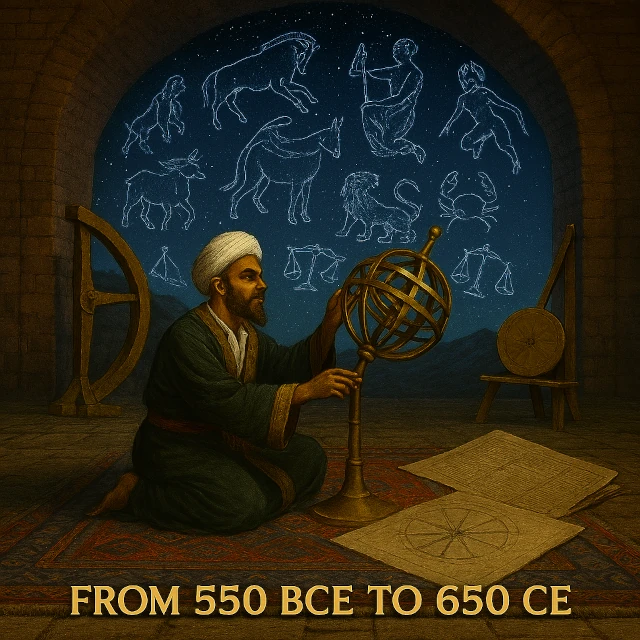
L'astronomie perse antique, s'étendant de l'Empire achéménide (550-330 BCE) à la chute de l'Empire sassanide (224-651 CE), représente un maillon essentiel dans la chaîne de transmission des connaissances astronomiques entre l'Antiquité et le monde médiéval. Située au carrefour des grandes civilisations, la Perse a absorbé, préservé et enrichi les savoirs babyloniens, grecs et indiens, jouant un rôle crucial dans leur transmission vers le monde islamique qui allait dominer l'astronomie pendant près de huit siècles.
L'astronomie islamique ne s'est pas développée ex nihilo après les conquêtes arabes du VIIe siècle. Elle s'est édifiée sur les fondations solides établies par les astronomes perses sassanides, qui avaient eux-mêmes hérité et transformé les traditions mésopotamiennes millénaires.
N.B. :
Les Perses achéménides (6ᵉ–4ᵉ siècle BCE) et les Sassanides (3ᵉ–7ᵉ siècle CE) sont les deux grandes dynasties impériales de la Perse antique. Les Achéménides bâtissent un vaste empire multiethnique doté d’une administration structurée et les Sassanides recentrent le pouvoir autour des enseignements du prophète Zarathoustra et consolident l’appareil administratif.
Lorsque Cyrus II le Grand (vers 600-530 BCE) conquiert Babylone en 539 BCE, il s'approprie un héritage scientifique millénaire. Les Perses achéménides adoptent rapidement les méthodes astronomiques babyloniennes, notamment les éphémérides et les techniques de prédiction des éclipses développées depuis le 8ᵉ siècle BCE.
Les tablettes cunéiformes de la période achéménide, découvertes à Babylone et à Uruk, attestent de la continuité des observations astronomiques babyloniennes sous domination perse.
Les astronomes perses ont commenté, critiqué et amélioré les textes anciens. Cette tradition de synthèse scientifique caractérisera l'astronomie islamique naissante, où des savants d'origines diverses (arabes, perses, turcs, andalous) collaboreront dans une langue scientifique commune, l'arabe.
N.B. :
L'Académie de Gundishapur, fondée au VIe siècle sous les Sassanides, fut le principal centre intellectuel de son époque et servit de modèle à la Maison de la Sagesse de Bagdad. Elle combinait enseignement médical, astronomique, mathématique et philosophique, attirant des savants de toute l'Asie occidentale.
| Période / Date | Événement ou contribution | Importance | Héritage |
|---|---|---|---|
| 539 BCE | Conquête de Babylone par Cyrus II | Adoption des observations babyloniennes (planètes, éclipses) | Continuité des observations à Babylone et Uruk |
| Période achéménide (550-330 BCE) | Développement du calendrier zoroastrien | Année de 365 jours, stabilisation saisonnière | Utilisé jusqu'à la période islamique (8ᵉ–15ᵉ siècle CE) |
| Période achéménide | Adoption du système sexagésimal babylonien | Cercle en 360°, heure en 60 min, base trigonométrique | Système utilisé aujourd'hui mondialement |
| Période séleucide (312-63 BCE) | Introduction de l'astronomie grecque | Fusion modèles grecs et données babyloniennes | Base de l'astronomie mathématique médiévale |
| Période séleucide | Adoption du zodiaque grec et des épicycles | Modèles géométriques pour mouvements planétaires | Fondement du système ptoléméen en Perse |
| 224-242 CE | Règne d'Ardachîr Ier | Réforme calendaire, correction saisonnière | Amélioration de la précision calendaire |
| IIIe-VIe siècle CE | Astrologie perse horoscopique | Fusion babylonienne, grecque et indienne | Influence sur l'astrologie islamique et européenne |
| 531-579 CE | Règne de Khosro Ier Anushirvan | Création de l’Académie de Gundishapur | Centre intellectuel majeur avant Bagdad |
| Vers 550 CE | Introduction concepts indiens : sinus, zéro | Trigonométrie et calculs améliorés | Adoption par les astronomes islamiques |
| VIe siècle | Traductions d'ouvrages grecs et indiens | Accès direct à l’Almageste et méthodes numériques | Préservation des textes antiques |
| VIe siècle | Introduction de l'astronomie indienne (Siddhanta) | Fonction sinus pour calculs angulaires | Enrichissement des méthodes de calcul |
| VIe siècle | Perfectionnement de l'astrolabe planisphérique | Instrument universel pour calculs et navigation | Largement utilisé dans le monde islamique et européen |
| VIe-VIIe siècle | Observations systématiques des éclipses | Affinement des paramètres orbitaux | Révision des paramètres ptoléméens |
| Période sassanide tardive | Compilation du Zīk-i Shahriyārān | Tables hybrides babyloniennes, grecques et indiennes | Modèle pour les premiers zīj islamiques |
| Période sassanide tardive | Calcul de la précession des équinoxes | Quantification du mouvement lent de l’axe terrestre | Affinement par Al-Biruni et astronomes islamiques |
| 632-651 CE | Règne de Yazdgard III | Dernier calendrier sassanide, référence astronomique | Utilisé par les astronomes islamiques |
| 633-654 CE | Conquête arabe de la Perse | Transmission des méthodes et tables perse | Continuité de la tradition astronomique perse |
| 762 CE | Fondation de Bagdad | Calcul astrologique pour emplacement de la ville | Début de l'âge d'or de l'astronomie islamique |
| Vers 770 CE | Al-Fazari compile le premier zīj arabe | Corpus numérique arabe basé sur tables sassanides | Premier zīj du monde islamique |
| Vers 820 CE | Al-Hajjaj traduit l'Almageste | Diffusion du modèle ptoléméen en arabe | Base de l'astronomie islamique classique |
| 830 CE | Al-Khwarizmi publie son zīj | Synthèse perse, indienne et grecque | Modèle pour les zīj ultérieurs pendant 3 siècles |
Source : Encyclopaedia Iranica et Institute for the History of Arab and Islamic Science.
La conquête d’Alexandre le Grand et la période séleucide introduisent l’astronomie grecque en Perse. Les modèles géométriques d’Hipparque et Ptolémée complètent les méthodes arithmétiques babyloniennes. La synthèse babylonienne-grecque, centrée sur les épicycles et déférents, prépare le terrain pour l’astronomie mathématique médiévale, avec adoption des divisions zodiacales et de la longitude écliptique.
Sous les Sassanides (224-651 CE), et particulièrement Khosro Ier, la Perse devient un centre intellectuel majeur via l’Académie de Gundishapur. Une grande synthèse s’opère entre traditions babylonienne, grecque et indienne : traductions de l’Almageste et du Siddhanta, introduction de la trigonométrie indienne, création de tables astronomiques perses (zīk) combinant observations et modèles géométriques.
Les Perses utilisent et perfectionnent les instruments hérités des civilisations antérieures : gnomon, cadrans solaires, sphère armillaire et astrolabe. Les observations sont méthodiquement consignées dans des journaux astronomiques, permettant d’affiner les modèles et de détecter les limites du système ptoléméen.
Le calendrier, lié au zoroastrisme, initialement de 365 jours sans correction, est progressivement réformé. Sous Ardachîr Ier et Yazdgard III, il devient plus précis, reflétant la cosmologie zoroastrienne avec 12 mois dédiés aux Amesha Spentas et aux yazata, intégrant ainsi observation astronomique et piété religieuse.
L’astrologie est indissociable de l’astronomie et influence les décisions royales. La cosmologie conçoit l’univers comme création d’Ahura Mazda, avec correspondance entre les planètes et les Amesha Spentas. Le concept de Zervanism conduit à une vision cyclique du temps, préfigurant l’étude de la précession des équinoxes par les astronomes islamiques.
Les astronomes sassanides compilent des tables sophistiquées, appelées zīk, contenant positions planétaires, éclipses et données trigonométriques. Le Zīk-i Shahriyārān, basé sur des observations accumulées pendant plusieurs siècles, influence directement les premiers zīj islamiques. Ces tables utilisent le système sexagésimal babylonien et combinent modèles ptoléméens, observations perses et méthodes de calcul indiennes.
La conquête arabe préserve et adopte la tradition perse. La fondation de Bagdad (762 CE) et de la Bayt al-Hikma permet la traduction des textes scientifiques grecs et persans en arabe. Les astronomes perses, tels qu’Al-Hajjaj ibn Yusuf et les Banu Musa, assurent la continuité et l’évolution de l’astronomie vers la période islamique classique.
L'astronomie perse antique illustre parfaitement comment les connaissances scientifiques se transmettent et s'enrichissent à travers les siècles et les civilisations. Loin d'être une simple phase intermédiaire, elle constitue un moment de synthèse créative.