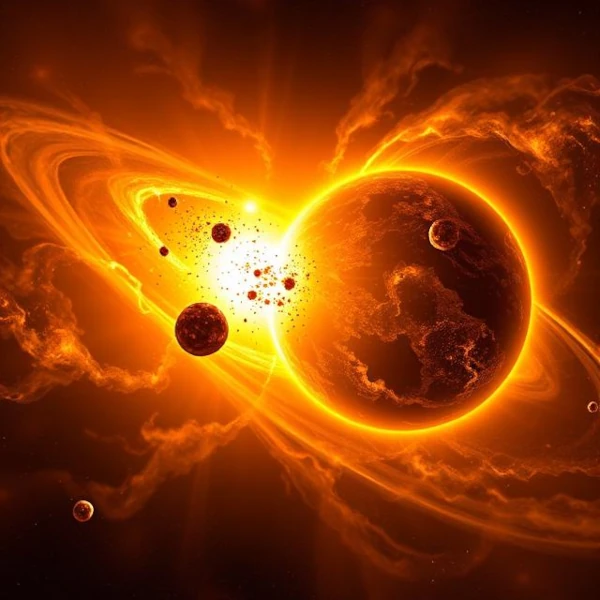
Et si notre système solaire avait abrité des mondes géants aujourd'hui disparus ? Des diamants extraterrestres retrouvés dans des météorites révèlent l'existence passée de super-Terres, ces planètes rocheuses massives qui auraient orbité autour du jeune Soleil avant d'être éjectées dans l'espace interstellaire.
Les super-Terres sont parmi les exoplanètes les plus courantes observées dans la Voie lactée. Pourtant, notre système solaire en est dépourvu. Cette absence apparente, alors que la nature semble favoriser leur formation, suggère qu’elles ont bien existé avant de disparaître. Les indices matériels les plus convaincants proviennent de certaines météorites contenant des diamants de haute pression, formés à l’intérieur de corps planétaires massifs aujourd’hui perdus.
Les analyses des météorites uréilites ont révélé des cristaux de diamant de plusieurs dizaines de microns, présentant des inclusions métalliques (Fe, Ni, Cr) formées à plus de 20 GPa. Ces pressions ne peuvent être atteintes que dans des planètes rocheuses de plusieurs masses terrestres, bien au-delà des capacités d’un simple astéroïde.
En considérant la densité moyenne terrestre, une pression de 15 à 20 GPa correspond à un corps d’environ 2 à 5 masses terrestres, c’est-à-dire une super-Terre. Ces diamants témoignent donc de l’existence d’un manteau planétaire soumis à des conditions internes comparables à celles d’Uranus ou de Neptune.
N.B. :
Les uréilites diamantifères pourraient représenter les seuls témoins minéralogiques des super-Terres perdues du système solaire primitif. Leurs structures internes témoignent de pressions inaccessibles à de simples astéroïdes, soutenant l’idée d’une population planétaire disparue avant la stabilisation des orbites actuelles.
Les simulations de Sean Raymond et Alessandro Morbidelli montrent que Jupiter aurait joué le rôle de barrière gravitationnelle, empêchant la migration des super-Terres vers l’intérieur du système solaire. Cette interaction aurait conduit à leur éjection ou destruction. Le phénomène est décrit dans le cadre du modèle du Grand Tack, où Jupiter migre vers 1,5 UA avant de revenir vers l’extérieur, déstabilisant les embryons planétaires.
Le modèle du Grand Tack (Grand Virement) est une hypothèse dynamique proposée par Alessandro Morbidelli et Sean Raymond, décrivant la migration précoce de Jupiter et Saturne dans la nébuleuse primitive. Selon ce modèle, Jupiter aurait d’abord migré vers le Soleil jusqu’à ≈ 1,5 UA avant de faire « demi-tour » sous l’effet résonant de Saturne. Ce mouvement aurait perturbé les embryons planétaires internes, éjecté d’éventuelles super-Terres et limité la masse finale de Mars. Le terme « tack » vient de la manœuvre de virement de bord en navigation, illustrant le changement de direction gravitationnel des deux géantes.
Une super-Terre atteignant une vitesse d’éjection supérieure à 42 km/s aurait pu devenir une planète interstellaire, quittant définitivement le système solaire.
La météorite Almahata Sitta, tombée au Soudan en 2008, contient des diamants de haute pureté, confirmés par spectroscopie. Les inclusions métalliques qu’elle renferme exigent une formation à des pressions de 20 à 25 GPa. Selon Farhang Nabiei (EPFL, 2018), ces diamants proviennent d’un corps parent d’une taille comparable à celle de Mercure ou d’une super-Terre de plusieurs masses terrestres.
Les scientifiques utilisent plusieurs techniques pour dater et caractériser ces diamants extraterrestres :
L’absence de super-Terres pourrait avoir favorisé la stabilité gravitationnelle du système solaire. Sans ces masses intermédiaires, les planètes actuelles occupent des orbites quasi circulaires, évitant les résonances destructrices. Cette stabilité prolongée a permis l’évolution lente et continue de la vie sur Terre, un scénario exceptionnel dans les statistiques exoplanétaires.
| Type de système | Proportion observée | Structure gravitationnelle | Commentaires physiques |
|---|---|---|---|
| Système simple (une seule étoile) | ≈ 45 % | Une étoile centrale unique | Stable et fréquent pour les étoiles de faible masse, comme le Soleil. |
| Système binaire | ≈ 40 % | Deux étoiles en orbite mutuelle autour de leur barycentre | Peut engendrer des perturbations planétaires mais favorise aussi les échanges de matière. |
| Système tertiaire (triple) | ≈ 10 % | Deux étoiles proches accompagnées d’une troisième plus lointaine | Stabilité conditionnelle : nécessite une hiérarchie orbitale stricte pour éviter l’éjection gravitationnelle. |
| Système multiple (≥ 4 étoiles) | ≈ 5 % | Enchaînement d’orbites imbriquées autour de plusieurs barycentres secondaires | Très instables sur le long terme ; souvent issus de la fragmentation initiale d’un nuage moléculaire. |
Sources : Raghavan et al. (2010), ApJS, 190, 1 ; Tokovinin (2018), ApJS, 235, 6 ; Mission Gaia, ESA (2023).
| Type spectral | Masse moyenne (M⊙) | Taux de systèmes multiples (approx.) | Implication physique |
|---|---|---|---|
| O–B (massives) | ≈ 8–40 | ≈ 80–100 % | Formation dans des noyaux instables, forte fragmentation du nuage, très haute probabilité de binarité et de multiples proches. |
| A–F | ≈ 1.5–2.5 | ≈ 60–75 % | Fragmentation modérée ; systèmes multiples fréquents mais plus hiérarchiques. |
| G (étoiles solaires) | ≈ 1.0 | ≈ 45 % | Mixte : une fraction substantielle de binaires mais nombre important d’étoiles isolées. |
| K | ≈ 0.6–0.9 | ≈ 30–40 % | Moins de compagnons ; disques protoplanétaires souvent plus stables. |
| M (naines rouges) | ≈ 0.1–0.5 | ≈ 20–30 % | Population dominante en nombre dans la Galaxie ; faible multiplicité entraîne une majorité d’étoiles solitaires. |
| Tous types (moyenne pondérée) | — | ≈ 40–45 % | Valeur moyenne pondérée par la fonction initiale de masse (IMF) : la grande proportion de naines rouges abaisse la moyenne globale. |
N.B. :
L’affirmation souvent lue selon laquelle "80 % des étoiles sont binaires" est correcte pour les populations d’étoiles **massives** observées (O–B), mais elle est trompeuse si elle est étendue à l’ensemble des étoiles de la Galaxie. La Galaxie étant dominée numériquement par les naines rouges (type M) qui ont un taux de multiplicité faible, la moyenne pondérée donne ≈ 40–45 % de systèmes multiples au niveau galactique.