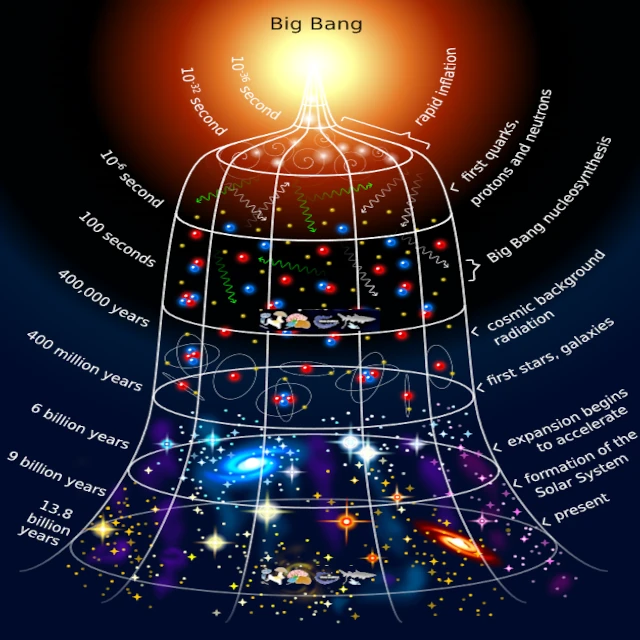
Depuis Charles Darwin (1809-1882), la théorie de l’évolution repose sur le principe de la sélection naturelle. Celle-ci favorise la transmission des caractères les mieux adaptés à l’environnement. Dans l’imaginaire collectif, cette évolution est souvent perçue comme une progression linéaire vers une complexité croissante. Pourtant, la nature montre que l’évolution n’a pas de direction privilégiée : elle peut aussi aboutir à des formes simplifiées, des pertes d’organes, voire à une véritable dévolution.
L’évolution n’a ni direction, ni finalité. Elle explore les possibles offerts par l’environnement et conserve ce qui fonctionne, même si cela signifie une simplification apparente. Comme le soulignait Stephen Jay Gould (1941-2002), la complexité n’est qu’une conséquence accidentelle de la vie, non sa destination. La dévolution rappelle que la nature ne « progresse » pas, elle s’adapte.
N.B. :
Le terme dévolution n’est pas reconnu comme concept formel par la biologie moderne. Il s’agit d’une description métaphorique pour désigner les processus de perte fonctionnelle ou de simplification évolutive.
Dans sa théorie "De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie" (1859), Charles Darwin n’emploie jamais le mot "évolution". Le terme n’apparaît qu’une seule fois, et encore, uniquement dans la dernière édition (la 6ᵉ de 1872), dans la phrase finale : “Il y a de la grandeur dans cette conception de la vie... à partir d’un commencement si simple, d’innombrables formes, les plus belles et les plus merveilleuses, ont été, et sont encore, engendrées par évolution.”
Darwin se méfiait du mot "évolution", car avant lui, il désignait surtout un développement préprogrammé, un déploiement d’un plan interne (notamment chez Lamarck) or, sa théorie reposait justement sur l’absence de plan ou de direction.
L'ascension continue vers plus d'intelligence, de taille et de perfection est une vision, teintée d'anthropocentrisme, un contresens sur la théorie de Charles Darwin. Parfois, la meilleure adaptation consiste à régresser.
La dévolution n’est pas une "régression" au sens péjoratif du terme. Elle décrit plutôt un phénomène évolutif où un organisme perd des caractères complexes au profit d'une forme plus simple. Ce n'est pas un retour en arrière vers un ancêtre, mais une nouvelle adaptation par soustraction. La force motrice n'est pas la "régression" mais une pression de sélection qui favorise la simplicité lorsque la complexité devient un fardeau.
Toute structure complexe a un coût. Chaque organe, chaque réseau cellulaire ou gène exprimé consomme de l’énergie, requiert un contrôle génétique et une maintenance. Lorsque l’environnement n’exige plus certaines fonctions, la pression sélective qui les maintenait disparaît. L’espèce gagne en économie énergétique en simplifiant son architecture biologique.
| Organisme | Caractère perdu ou simplifié | Cause ou contexte adaptatif | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Poisson cavernicole Astyanax mexicanus | Perte des yeux et de la pigmentation | Vie dans l’obscurité totale, économie d’énergie | Perdre la vue n'est pas une "erreur" de l'évolution ; c'est une adaptation remarquable qui a permis à ces espèces de conquérir une niche écologique extrême. |
| Ténia (Taenia solium) | Disparition du tube digestif | Absorption directe des nutriments de l’hôte | Réduction extrême du métabolisme et perte de son système digestif, aboutissant à une spécialisation parasitaire complète où l'organise survit en absorbant directement les nutriments de son hôte. |
| Serpents (descendants de lézards) | Membres antérieurs Membres postérieurs | Adaptation au fouissage Locomotion par ondulation | La perte des membres est corrélée à des modes de vie fouisseurs ou à une locomotion par ondulation du corps, plus efficace pour se faufiler dans des terriers ou poursuivre des proies. |
| Baleine (Balaenoptera musculus) | Perte des membres postérieurs | Adaptation complète au milieu aquatique | Des membres arrière seraient une source de traînée et rendraient la nage bien moins efficace. |
| Manchot (Aptenodytes forsteri) | Perte du vol | Transformation des ailes en nageoires | Conversion aérodynamique vers l’hydrodynamique pour une propulsion efficace sous l’eau. |
| Autruche (Struthio camelus) | Incapacité à voler | Adaptation à la course rapide terrestre | Énergie redirigée vers la course : Les ailes résiduelles servent à l’équilibre et à la parade nuptiale. |
| Fourmi coupe-feuille Atta cephalotes | Capacité à digérer la cellulose | Symbiose avec champignon Division du travail | Ayant externalisé leur digestion de la cellulose à des champignons symbiotiques, elles ont perdu cette capacité physiologique, favorisant ainsi une spécialisation collective où chaque membre de la colonie contribue à un système alimentaire mutualiste. |
| Oiseau Apteryx australis (kiwi) | Réduction des ailes et des yeux | Vie nocturne et terrestre dans les forêts néo-zélandaises | Son plumage a régressé vers une texture duveteuse semblable à des poils, tandis que ses narines terminales et son odorat hyper-développé compensent cette simplification, en faisant un prédateur nocturne spécialisé. |
| Amphibien Proteus anguinus | Perte des yeux fonctionnels | Vie souterraine dans les grottes calcaires | Organes visuels atrophiés remplacés par une sensibilité cutanée à la lumière. |
Comment la nature, sans intention ni direction, produit-elle une organisation croissante de la matière vivante, depuis la cellule primitive jusqu’aux organismes pluricellulaires complexes ?
La réponse réside dans la thermodynamique des systèmes ouverts et dans la logique de l’auto-organisation.
L’évolution biologique n’est pas un progrès, mais une exploration des possibles. L’évolution n’a aucune finalité (aucun but d’aller vers la complexité). Chaque transformation biologique est simplement le résultat de contraintes locales : mutations aléatoires, interactions physiques et chimiques, et sélection naturelle dans un environnement donné. Or, certaines de ces contraintes favorisent l’émergence de structures stables, c'est-à-dire plus organisées.
Ainsi, la complexité croissante que nous observons dans la biosphère n’est pas une tendance universelle, mais un effet collatéral de la physique des systèmes dissipatifs.
Un système vivant est un système ouvert, loin de l’équilibre thermodynamique. Il échange continuellement de la matière et de l’énergie avec son environnement. Selon la théorie d’Ilya Prigogine (1917-2003), ces systèmes peuvent s’auto-organiser lorsque le flux d’énergie dépasse un certain seuil critique.
N.B. :
Principe : un flux d’énergie constant peut maintenir une structure ordonnée, tant qu’il y a dissipation d’entropie vers l’extérieur.
La transition vers la cellule eucaryote n’est pas un "progrès", mais le résultat d’une symbiose stabilisée. Une cellule primitive (archée) a intégré une bactérie aérobie, devenue mitochondrie. Ce processus d’endosymbiose a permis d’exploiter plus efficacement l’énergie, augmentant ainsi la capacité d’auto-organisation. C’est une transition énergétique avant d’être une transition hiérarchique.
Lorsque des cellules semblables coopèrent pour mieux gérer les flux d’énergie et de nutriments, une différenciation fonctionnelle émerge naturellement. Certaines cellules se spécialisent pour la structure, d’autres pour la reproduction, d’autres pour la communication.
Chaque niveau d’organisation (cellule → tissu → organe → organisme) n’est pas le produit d’un "plan" mais d’une stabilisation progressive des interactions. Plus un système échange de l’énergie et maintient une mémoire (information génétique, épigénétique, ou chimique), plus il peut se structurer sans perdre son équilibre dynamique. Du point de vue physique, maintenir une structure ordonnée et complexe requiert un flux constant d’énergie.
\( \text{Complexité} \approx \text{Stabilité} + \text{Flux d'énergie} + \text{Information conservée} \)