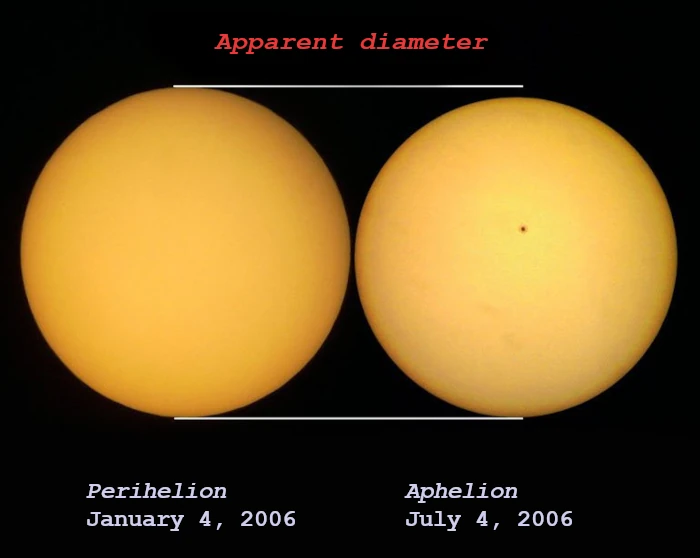
Le Soleil est une étoile de type spectral G2V, âgée d’environ 4,57 milliards d’années, située à une distance moyenne de 1 UA (≈ 149 597 870 km) de la Terre. Il s’agit d’une sphère de plasma d’environ 1 392 700 km de diamètre, principalement composée d’hydrogène (≈ 73,5 %) et d’hélium (≈ 24,9 %), avec une faible proportion d’éléments plus lourds appelés métaux.
L’équilibre interne du Soleil résulte de la compensation entre deux forces fondamentales : la pression de radiation générée par la fusion de l’hydrogène en hélium dans son cœur, et la gravité qui tend à l’effondrer. Cette condition d’équilibre, appelée équilibre hydrostatique, garantit la stabilité de l’étoile sur la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell (1905-1969).
Le noyau solaire, d’un rayon ≈ 0,25 R☉, atteint des températures proches de \(1,5\times10^7\,K\) et des densités d’environ 150 g/cm (soit 150 000 kg/m³), environ 25 fois plus dense que le noyau terrestre. Les réactions de fusion s’y déroulent selon la chaîne proton-proton, produisant une énergie de \(3,8\times10^{26}\,W\). Cette puissance colossale, transportée vers la surface d’abord par radiation puis par convection, se convertit en rayonnement électromagnétique observé depuis la Terre.
La masse solaire représente 99,86 % de celle du Système solaire, exerçant une influence gravitationnelle déterminante sur l’ensemble des planètes, astéroïdes et comètes. Son flux énergétique moyen au niveau de la Terre, appelé constante solaire, vaut environ \(1 361\,W/m^2\), et c’est lui qui régit le climat, la photosynthèse et la dynamique atmosphérique de notre planète.
N.B. :
Une étoile de type spectral G2V appartient à la classe des naines jaunes. La lettre « G » désigne la température de surface, comprise entre 5 300 K et 6 000 K, tandis que le chiffre « 2 » précise la sous-classe plus chaude au sein du type G. Le suffixe « V » indique qu’il s’agit d’une étoile de la séquence principale, c’est-à-dire en phase de fusion stable de l’hydrogène en hélium. Le Soleil, avec une température photosphérique moyenne de 5 778 K et une luminosité d’un Soleil (\(L = 1 L_\odot\)), sert de référence à cette classification.
Le Soleil est né il y a environ 4,6 milliards d’années au cœur d’un vaste nuage moléculaire du bras d’Orion, dans la Voie lactée. Sous l’action combinée de la gravité et d’une onde de choc, probablement issue d’une supernova voisine, une partie du nuage entra en effondrement gravitationnel. La matière commença alors à se concentrer au centre d’une région dense (la protoétoile solaire) tandis qu’un disque d’accrétion se formait autour d’elle.
Au cours de cet effondrement, la conservation du moment cinétique provoqua une rotation accélérée du disque et un aplatissement progressif de la structure. La température et la densité augmentèrent considérablement dans le cœur de la protoétoile ; lorsque la température centrale atteignit environ \(10^7\,K\), les collisions entre protons devinrent suffisamment fréquentes pour déclencher la fusion thermonucléaire selon la chaîne proton-proton.
La réaction dominante, décrite pour la première fois par Hans Bethe (1906-2005), peut être résumée ainsi : \( 4\,^1H \rightarrow\, ^4He + 2e^+ + 2\nu_e + 26,7\,\text{MeV} \)
Cette conversion de masse en énergie, exprimée par l’équation d’Albert Einstein (1879-1955) \(E = mc^2\), libéra un flux d’énergie suffisant pour stopper la contraction gravitationnelle du jeune Soleil. L’étoile entra alors dans une phase de stabilité thermique, marquant son installation sur la séquence principale.
Les résidus du disque d’accrétion, quant à eux, donnèrent naissance à la matière primitive du Système solaire : planètes, satellites, astéroïdes et comètes. Cette phase, d’une durée estimée à quelques dizaines de millions d’années, scella les conditions initiales de l’évolution future de notre environnement planétaire.
Durant la majeure partie de son existence, le Soleil demeure une étoile stable de la séquence principale. Cette stabilité résulte d’un équilibre entre la pression exercée par le rayonnement issu de la fusion nucléaire et la force gravitationnelle qui tend à comprimer la matière. Cet état d’équilibre hydrostatique garantit une structure quasi-stationnaire pendant environ 10 milliards d’années.
| Région | Étendue radiale | Température caractéristique | Mode de transport d’énergie | Particularités physiques |
|---|---|---|---|---|
| Noyau | 0 → 0,25 R☉ | \(1,5\times10^7\,K\) | Fusion thermonucléaire (chaîne proton-proton) | Production principale d’énergie ; 99 % de la puissance totale du Soleil y est générée. |
| Zone radiative | 0,25 → 0,70 R☉ | \(5\times10^6\) à \(2\times10^6\,K\) | Diffusion radiative | Les photons sont continuellement absorbés et réémis ; le transfert d’énergie est extrêmement lent (jusqu’à 105 ans). |
| Zone convective | 0,70 → 1,00 R☉ | \(2\times10^6\) à \(5\times10^3\,K\) | Convection thermique | Colonnes de plasma chaud montant et descendant ; responsable des granulations observées à la surface. |
| Photosphère | ≈ 1,00 R☉ | \(5\,778\,K\) | Émission de rayonnement | Surface visible du Soleil ; émet le spectre continu avec raies d’absorption (raies de Fraunhofer). |
La rotation différentielle du Soleil, plus rapide à l’équateur (≈ 25 jours) qu’aux pôles (≈ 35 jours), entraîne des cisaillements dans la zone de transition appelée tachocline. Ces cisaillements amplifient et tordent les lignes de champ magnétique, générant par effet dynamo un champ complexe et variable.
Ce champ magnétique est responsable des taches solaires, des flares et du vent solaire. Leur activité suit un cycle moyen de 11 ans, identifié dès 1843 par Heinrich Schwabe (1789-1875) et approfondi par George Ellery Hale (1868-1938) grâce à la découverte du magnétisme solaire.
Ce cycle influence l’ensemble de l’héliosphère, modulant la quantité de particules énergétiques atteignant la Terre et affectant ainsi la ionosphère, les communications radio et même la formation des aurores polaires. L’activité du Soleil constitue donc une variable astrophysique majeure du climat spatial.
Dans environ 5 milliards d’années, l’hydrogène du noyau solaire sera épuisé, entraînant l’arrêt de la fusion nucléaire centrale. Privé de la pression de radiation nécessaire pour compenser la gravité, le noyau commencera à s’effondrer. Le réchauffement central déclenchera la fusion de l’hélium en carbone et oxygène via le processus triple-alpha. Les couches externes se dilateront, transformant le Soleil en une géante rouge. Son rayon pourrait atteindre l’orbite actuelle de la Terre.
Durant cette phase, le Soleil subira des pulsations thermiques et perdra une partie significative de sa masse via des vents stellaires intenses. L’éjection des couches externes formera une nébuleuse planétaire, enrichissant le milieu interstellaire en carbone et autres éléments légers.
Le cœur résiduel se contractera sous l’effet de la gravité jusqu’à devenir une naine blanche. Sa masse sera d’environ 0,6 M☉ et son rayon comparable à celui de la Terre. À ce stade, aucune fusion nucléaire ne se produira et l’étoile rayonnera uniquement par son énergie résiduelle, refroidissant lentement sur des milliards d’années jusqu’à devenir éventuellement une naine noire.
| Phase | Durée estimée | Caractéristiques physiques | État énergétique |
|---|---|---|---|
| Protoétoile | ~107 ans | Effondrement du nuage de gaz et poussières | Chauffage gravitationnel |
| Séquence principale | ~1010 ans | Fusion H → He stable | Équilibre hydrostatique |
| Géante rouge | ~108 ans | Fusion He → C, O dans le cœur | Instabilités thermiques |
| Naine blanche | ∞ (refroidissement lent) | Noyau dégénéré | Rayonnement résiduel |
Source : NASA – Solar Physics et Harvard ADS.