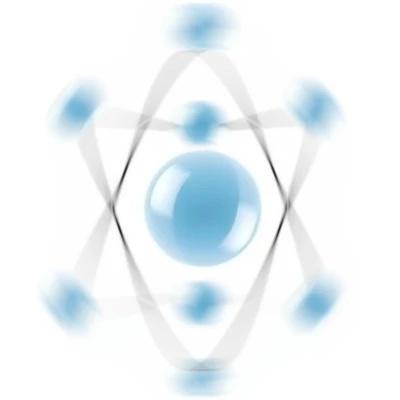
L'oxygène fut découvert indépendamment par plusieurs chimistes dans les années 1770. Le chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) isola l'oxygène en 1772 en chauffant divers oxydes, mais ses travaux ne furent publiés qu'en 1777. En 1774, le théologien et chimiste britannique Joseph Priestley (1733-1804) produisit de l'oxygène en concentrant la lumière solaire sur de l'oxyde de mercure à l'aide d'une lentille. Il observa qu'une bougie brûlait plus vivement dans ce gaz et qu'une souris y survivait plus longtemps. C'est Antoine Lavoisier (1743-1794) qui, entre 1775 et 1780, comprit véritablement la nature de l'oxygène et son rôle dans la combustion et la respiration, renversant ainsi la théorie du phlogistique. Lavoisier nomma cet élément oxygène (du grec oxys = acide et genes = générer), croyant à tort que tous les acides contenaient de l'oxygène. Cette découverte marqua le début de la chimie moderne.
L'oxygène (symbole O, numéro atomique 8) est un non-métal du groupe 16 (chalcogènes) du tableau périodique, constitué de huit protons, généralement huit neutrons (pour l'isotope le plus courant) et huit électrons. Les trois isotopes stables sont l'oxygène-16 \(\,^{16}\mathrm{O}\) (≈ 99,757 %), l'oxygène-17 \(\,^{17}\mathrm{O}\) (≈ 0,038 %) et l'oxygène-18 \(\,^{18}\mathrm{O}\) (≈ 0,205 %).
À température ambiante, l'oxygène se présente sous forme de gaz diatomique (O₂), incolore, inodore et très réactif chimiquement. La molécule O₂ possède une configuration électronique particulière avec deux électrons non appariés, lui conférant des propriétés paramagnétiques (l'oxygène liquide est attiré par un aimant). L'oxygène gazeux constitue environ 21 % de l'atmosphère terrestre en volume et est essentiel à la respiration aérobie. Le gaz O₂ a une densité d'environ 1.429 g/L à température et pression standard.
L'oxygène existe également sous forme d'ozone (O₃), une forme allotropique triatomique, bleu pâle, à l'odeur caractéristique, qui absorbe fortement les rayons ultraviolets. La couche d'ozone stratosphérique protège la vie terrestre des radiations UV nocives.
La température à laquelle les états liquide et solide peuvent coexister (point de fusion) : 54,36 K (−218,79 °C). La température à partir de laquelle il passe de l'état liquide à l'état gazeux (point d'ébullition) : 90,188 K (−182,962 °C). L'oxygène liquide présente une couleur bleu pâle caractéristique.
| Isotope / Notation | Protons (Z) | Neutrons (N) | Masse atomique (u) | Abondance naturelle | Demi-vie / Stabilité | Décroissance / Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène-15 — \(\,^{15}\mathrm{O}\,\) | 8 | 7 | 15.003066 u | Non naturel | 122.24 s | Radioactif β\(^+\) donnant \(\,^{15}\mathrm{N}\) ; utilisé en tomographie par émission de positrons (TEP) médicale. |
| Oxygène-16 — \(\,^{16}\mathrm{O}\,\) | 8 | 8 | 15.994915 u | ≈ 99.757 % | Stable | Isotope ultra-majoritaire ; base de la biochimie et de la respiration ; ancienne référence des masses atomiques. |
| Oxygène-17 — \(\,^{17}\mathrm{O}\,\) | 8 | 9 | 16.999132 u | ≈ 0.038 % | Stable | Seul isotope de l'oxygène avec un spin nucléaire ; utilisé en spectroscopie RMN de l'oxygène-17. |
| Oxygène-18 — \(\,^{18}\mathrm{O}\,\) | 8 | 10 | 17.999160 u | ≈ 0.205 % | Stable | Traceur paléoclimatique majeur ; son rapport avec O-16 révèle les températures et volumes glaciaires du passé. |
| Oxygène-19 — \(\,^{19}\mathrm{O}\,\) | 8 | 11 | 19.003580 u | Non naturel | 26.464 s | Radioactif β\(^-\) donnant \(\,^{19}\mathrm{F}\) ; produit artificiellement dans les accélérateurs. |
| Autres isotopes — \(\,^{12}\mathrm{O}-\,^{14}\mathrm{O},\,^{20}\mathrm{O}-\,^{28}\mathrm{O}\) | 8 | 4-6, 12-20 | — (résonances) | Non naturels | \(10^{-21}\) — 13.51 s | États très instables observés en physique nucléaire ; certains présentent des structures de halo de neutrons. |
N.B. :
Les couches électroniques : Comment les électrons s'organisent autour du noyau.
L'oxygène possède 8 électrons répartis sur deux couches électroniques. Sa configuration électronique complète est : 1s² 2s² 2p⁴, ou de manière simplifiée : [He] 2s² 2p⁴. Cette configuration peut aussi s'écrire : K(2) L(6).
Couche K (n=1) : contient 2 électrons dans la sous-couche 1s. Cette couche interne est complète et très stable.
Couche L (n=2) : contient 6 électrons répartis en 2s² 2p⁴. Les orbitales 2s sont complètes, tandis que les orbitales 2p ne contiennent que 4 électrons sur 6 possibles. Il manque donc 2 électrons pour atteindre la configuration stable du néon avec 8 électrons (octet).
Les 6 électrons de la couche externe (2s² 2p⁴) constituent les électrons de valence de l'oxygène. Cette configuration explique ses propriétés chimiques :
En gagnant 2 électrons, l'oxygène forme l'ion O²⁻ (degré d'oxydation -2), son état d'oxydation le plus courant dans les oxydes, adoptant ainsi la configuration stable du néon [Ne].
L'oxygène peut également présenter le degré d'oxydation -1 dans les peroxydes (comme H₂O₂, l'eau oxygénée) et les superoxydes.
Dans certains composés avec le fluor (OF₂), l'oxygène présente exceptionnellement un degré d'oxydation positif +2, étant le seul élément capable de faire perdre des électrons à l'oxygène.
Le degré d'oxydation 0 correspond au dioxygène O₂, sa forme moléculaire naturelle, où deux atomes d'oxygène sont liés par une double liaison.
La configuration électronique de l'oxygène, avec 6 électrons sur sa couche de valence, le classe parmi les chalcogènes (groupe 16) et en fait le deuxième élément le plus électronégatif après le fluor (électronégativité de 3,5). Cette structure lui confère des propriétés caractéristiques : grande réactivité chimique (l'oxygène réagit avec presque tous les éléments), pouvoir oxydant puissant (deuxième après le fluor), et capacité à former deux liaisons covalentes pour compléter son octet. L'oxygène forme principalement l'ion oxyde O²⁻ dans les composés ioniques, mais peut aussi établir des liaisons covalentes en partageant ses électrons. Le dioxygène O₂ est un gaz incolore, inodore, paramagnétique, indispensable à la respiration des organismes aérobies. Sa molécule possède deux électrons non appariés, ce qui explique son paramagnétisme et sa réactivité. L'importance de l'oxygène est fondamentale : il représente environ 21% de l'atmosphère terrestre et environ 46% de la masse de la croûte terrestre (l'élément le plus abondant). Il est essentiel à la vie (respiration cellulaire, production d'énergie via l'ATP), à la combustion, et intervient dans d'innombrables processus chimiques. L'oxygène est utilisé industriellement dans la métallurgie (production d'acier), le soudage, les procédés chimiques, et en médecine (oxygénothérapie). L'ozone O₃, une forme allotropique, protège la Terre des rayons ultraviolets dans la stratosphère.
L'oxygène possède six électrons de valence et est le troisième élément le plus électronégatif (après le fluor et le chlore), ce qui en fait un oxydant extrêmement puissant. Il forme des composés avec pratiquement tous les autres éléments chimiques, à l'exception des gaz nobles légers (hélium, néon, argon). L'oxygène forme typiquement deux liaisons covalentes (comme dans H₂O, CO₂) ou des ions oxydes O²⁻ dans les composés ioniques.
Les réactions d'oxydation (combustion, respiration, rouille, etc.) impliquent le transfert d'électrons vers l'oxygène. La combustion de matières organiques avec l'oxygène libère de grandes quantités d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Cette réactivité élevée est exploitée dans d'innombrables processus naturels et industriels, mais rend aussi l'oxygène potentiellement dangereux : les atmosphères enrichies en oxygène augmentent considérablement les risques d'incendie.
L'oxygène forme des oxydes avec tous les éléments sauf les gaz nobles légers. Ces oxydes peuvent être basiques (oxydes métalliques comme CaO), acides (oxydes non-métalliques comme SO₂, CO₂) ou amphotères (comme Al₂O₃). L'eau (H₂O), le composé oxygéné le plus important, couvre 71 % de la surface terrestre et est essentielle à toute vie connue.
Dans les organismes vivants, l'oxygène est utilisé dans la respiration cellulaire aérobie pour oxyder les molécules organiques (glucose) et produire de l'énergie (ATP). Cette respiration génère également des espèces réactives de l'oxygène (radicaux libres) qui peuvent endommager les cellules, contre lesquelles les organismes ont développé des systèmes antioxydants. Paradoxalement, l'oxygène, essentiel à la vie aérobie, est aussi un poison oxydatif à forte concentration.
L'oxygène est le troisième élément le plus abondant dans l'univers observable (après l'hydrogène et l'hélium) et le premier élément lourd par abondance cosmique. Il représente environ 1 % de la masse baryonique totale de l'univers. Contrairement aux éléments primordiaux (H, He, Li), l'oxygène est entièrement produit par nucléosynthèse stellaire.
L'oxygène est principalement synthétisé dans les étoiles massives (supérieures à 8 masses solaires) par le processus de combustion du carbone et de l'hélium. La réaction triple-alpha produit du carbone-12, qui capture ensuite un noyau d'hélium-4 pour former de l'oxygène-16. À des températures plus élevées (environ 1 milliard de kelvins), la fusion du carbone produit également de l'oxygène. Les étoiles massives développent une structure en couches concentriques (comme un oignon) avec des zones de combustion de différents éléments, dont une couche riche en oxygène.
L'oxygène est massivement dispersé dans le milieu interstellaire lors des explosions de supernovae de type II. Ces événements cataclysmiques éjectent les couches externes riches en oxygène de l'étoile à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde, enrichissant le milieu interstellaire pour les générations futures d'étoiles et de planètes. L'oxygène représente une fraction significative de la masse éjectée par les supernovae, faisant de ces événements les principales sources d'oxygène galactique.
Dans le milieu interstellaire, l'oxygène existe sous plusieurs formes : atomique (O, O⁺, O⁺⁺), moléculaire (O₂, qui est rare et difficile à détecter), et incorporé dans de nombreuses molécules comme H₂O (glace d'eau), CO (monoxyde de carbone, la deuxième molécule la plus abondante après H₂), CO₂, OH, et des molécules organiques complexes. L'oxygène atomique ionisé (O⁺⁺, doublement ionisé) émet des raies spectrales caractéristiques dans les nébuleuses planétaires et les régions HII, permettant aux astronomes de cartographier la distribution de l'oxygène dans les galaxies.
Le rapport isotopique ¹⁶O/¹⁸O dans différents objets astronomiques (météorites, comètes, poussières interstellaires, grains présolaires) révèle des informations cruciales sur les processus de nucléosynthèse dans différents types d'étoiles et l'histoire de l'enrichissement chimique de notre galaxie. Des anomalies isotopiques de l'oxygène découvertes dans certaines inclusions réfractaires des météorites primitives indiquent la contribution de différentes sources stellaires au matériau qui a formé le système solaire.
Dans les atmosphères planétaires, l'oxygène joue un rôle central. Sur Terre, l'oxygène atmosphérique (21 % de O₂) est presque entièrement d'origine biologique, produit par la photosynthèse des plantes, algues et cyanobactéries depuis environ 2,4 milliards d'années (le « Grand Événement d'Oxygénation »). Cette accumulation d'oxygène a profondément transformé la chimie terrestre et permis l'évolution de la vie complexe aérobie. La détection spectroscopique d'oxygène moléculaire et d'ozone dans l'atmosphère d'une exoplanète pourrait constituer une biosignature potentielle, bien que des processus abiotiques puissent également produire de l'oxygène dans certaines conditions.
N.B. :
Le « paradoxe de l'oxygène » illustre la nature double de cet élément essentiel. L'oxygène moléculaire (O₂) est absolument vital pour les organismes aérobies, permettant une production d'énergie cellulaire efficace via la respiration mitochondriale. Cependant, l'oxygène est aussi un poison oxydatif puissant : ses dérivés réactifs (radicaux superoxydes, peroxyde d'hydrogène, radicaux hydroxyles) endommagent les protéines, les lipides et l'ADN. Les organismes aérobies ont dû développer des mécanismes antioxydants sophistiqués (enzymes comme la superoxyde dismutase, catalase, peroxydase ; molécules antioxydantes comme les vitamines C et E) pour se protéger de la toxicité de l'oxygène tout en exploitant son pouvoir énergétique. L'oxygène est également responsable du vieillissement cellulaire à travers l'accumulation de dommages oxydatifs au fil du temps. Cette dualité remarquable — élément vital et toxique simultanément — reflète l'histoire évolutive complexe de la vie sur Terre et les compromis biologiques nécessaires pour exploiter l'énorme potentiel énergétique de l'oxygène.